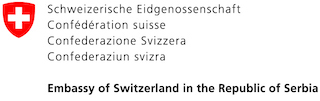Par Maya | Traduit de l’ukrainien par Alena Dubrovina
Ce texte est aussi disponible en ukrainien, serbe et allemand.
La guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à l’exil. Des Ukrainiens, mais aussi des Russes et des Biélorusses qui fuient le régime de Moscou et qui ont trouvé refuge en Serbie où une communauté s’organise. Que pensent-ils de la situation ? Comment vivent-ils l’exil et leur départ parfois sans retour ? Regards croisés.
Le cerveau humain est une chose passionnante, et certainement loin d’être complètement étudiée.
La guerre en Ukraine a commencé en 2014. C’est comme si c’était hier. Pourtant, ces dernières années, j’ai vécu comme s’il n’y avait rien de spécial dans le pays. Ce n’est pas parce que j’en avais marre de la guerre. Je voulais juste vivre ma vie. Et maintenant je le veux encore, mais je ne peux pas.
Comme un peu tout le monde, nous avions nos grands projets, parfois presque grandioses. Alors que tout le pays s’attendait à l’invasion, ma mère et moi nous nous sommes lancées dans une vie complètement différente. Nous nous préparions à déménager dans un autre endroit, et quand l’agent immobilier nous a dit qu’il serait difficile de vendre l’appartement à cause de la situation, nous n’y avons presque pas cru. Parce que nous avions des projets.
Tard dans la soirée du 23 février, j’ai reçu un appel de ma tante de Simferopol qui avait déménagé à Kiev il y a quelques années pour rejoindre ses enfants qui y vivaient depuis l’annexion de la Crimée. Nous communiquions très peu, presque pas du tout. D’un coup, elle a commencé à pleurer, en disant que les Russes allaient nous attaquer et se demandant comment on pourrait vivre maintenant, elle qui a grandi baignée dans la culture russe, avec Pouchkine, Tchaïkovski etc. C’était une conversation très étrange, mais avec ma mère nous avons mis cela sur le compte de l’âge tout à fait respectable de ma tante.
Tôt le matin du 24 février, la cousine de ma mère qui, elle aussi habite Kiev, a appelé ma mère et a commencé à crier quelque chose sur l’urgence de faire des stocks d’essence, affirmant qu’il n’y avait pas d’essence nulle part et d’autres choses du genre. Nous n’avons rien compris et j’ai dit qu’il devait y avoir à nouveau une sorte d’effondrement à Kiev. Maman a plaisanté en disant que la guerre a soudainement commencé et que nous avions tout raté en dormant, comme d’habitude. Il ne servait plus à rien d’aller se recoucher, nous sommes allées prendre du thé et du café en surfant sur les réseaux sociaux.
J’ai été la première à suivre les informations. Et là, j’ai compris toute l’horreur, ce n’était plus la même guerre, mais une invasion à grande échelle. Je ne me souviens plus quelles ont été mes premières pensées.
Ce jour-là, nous avons dû faire du bénévolat dans un refuge pour chiens. Nous étions alors un peu en retard, car il nous a fallu beaucoup de temps pour reprendre nos esprits et nous ne savions pas quoi faire. Je me souviens à quel point j’étais heureuse du fait que nous ayons un demi-réservoir de carburant et que ce soit suffisant pour faire l’aller-retour jusqu’au refuge pendant un certain temps. J’étais aussi soulagée à l’idée que les croquettes avaient été livrées il y a peu de temps et qu’il y avait assez de nourriture pour nos chiens à la maison. Cette journée a probablement été la plus courte de ma vie.
Après le refuge animalier, j’ai fait une longue promenade dans le parc avec le plus jeune de mes chiens. Et j’ai regardé les autres maîtres de chiens se promener, confus au beau milieu de leur journée de travail. La ville s’est brusquement mise à l’arrêt : pas d’essence, plus possible de payer par carte, pas d’argent liquide dans les distributeurs automatiques. J’avais des pensées contradictoires dans ma tête, sombres, mais je n’avais aucune intention de quitter la ville. J’ai passé toute la soirée sur les réseaux sociaux, à la recherche d’au moins quelques informations.
La première nouvelle effrayante pour moi a été l’annonce du meurtre par les occupants russes d’un dresseur et de ses chiens dans la région de Kharkiv. Il voulait sauver des animaux de compagnie, les évacuer de la ville assiégée. Cette vidéo terrible est toujours devant mes yeux. Sur les réseaux sociaux, une collègue de Biélorussie a écrit qu’il n’y avait aucune raison selon elle que les Ukrainiens et les Russes se disputent, ils devaient plutôt faire la paix. En réponse, je lui ai envoyé la vidéo en privé et lui ai demandé comment se réconcilier, alors qu’à la place de ce monsieur, j’aurais pu être visée avec mes chiens. Elle m’a répondu quelque chose comme « que veux-tu, ce qui se passe, c’est de la politique… ». Je n’avais pas de mots et j’ai radié tous les Russes et Biélorusses de la catégorie des êtres humains. Malheureusement, il semble qu’ils n’ont toujours rien compris.
En apparence, tout allait bien : la ville n’était pas occupée, pas bombardée, il y avait de l’électricité et du chauffage. Que demander de plus ?
La première semaine de guerre s’est déroulée dans un isolement total à la maison ou à la recherche de nourriture et de médicaments en prévention d’éventuelles urgences à venir.
Une semaine plus tard, des amis de l’étranger ont commencé à m’écrire et à me demander comment j’allais. C’était étrange car je ne savais pas quoi répondre. En apparence, tout allait bien : la ville n’était pas occupée, pas bombardée, il y avait de l’électricité et du chauffage. Que demander de plus ?
J’ai répondu qu’à Kharkiv, la situation avec les autres dresseurs de chiens était terrible. Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés sans logement, sans argent et, plus grave encore selon ma perception professionnelle, il n’y avait pas de nourriture pour les chiens dans la ville. Il fallait faire quelque chose. Des amis étrangers m’ont envoyé de l’argent, avec lequel j’ai acheté presque une tonne de nourriture. Il restait à trouver comment l’acheminer jusqu’à Kharkiv. Et il fallait aussi résoudre le problème de l’évacuation d’une amie d’enfance de ma mère…
Dans ce tourbillon de questions et de décisions à prendre, la vie était en quelque sorte plus simple : il n’y avait pas le temps de réfléchir. Même si des idées stupides se glissaient toujours dans ma tête. Par exemple, je me torturais l’esprit au sujet de mon plus jeune chien, qui n’avait que 5 mois à l’époque. Quelle imbécile j’avais été de l’avoir amené quelques mois plus tôt d’un pays de l’Union européenne pour m’en occuper en Ukraine ? Que faire maintenant : l’évacuer d’urgence, le rendre à l’éleveur ou lui chercher une nouvelle famille ?
À ce moment et jusqu’à aujourd’hui, les chiens m’ont toujours aidée à rester saine d’esprit, ou du moins à m’efforcer de l’être. Avoir huit chiens, est-ce avoir du bon sens ? En Ukraine, j’en avais cinq, mais c’est une autre histoire.
Je suis restée ainsi longtemps accablée, à cause de la situation dans la ville. Rien ne semblait bouger, et à cause de cela, mon cerveau a inventé toutes sortes de théories du complot. Un peu plus tard, des raids aériens ont commencé dans la région. Les premières sirènes ont beaucoup effrayé ma mère, surtout quand je n’étais pas chez nous parce que je devais promener les chiens et que l’alerte se déclenchait. Il n’y avait pas d’abri installé à proximité. Après un jour ou deux à subir ces alertes, nous nous y sommes habituées. Nous sommes même allées nous promener tranquillement une fois en l’entendant sonner. Jusqu’à ce que la première vraie attaque aérienne frappe Kiev.
Ma mère a couru vers moi de sa chambre, je lui ai crié de s’allonger immédiatement par terre et un deuxième coup a retenti.
Je m’en souviendrai toujours : c’était un samedi matin. La première explosion a retenti quelque part très proche de nous. J’ai roulé du lit sur le sol et j’ai presque écrasé mon chiot. Je ne sais toujours pas comment j’ai pu réagir si vite. Ma mère a couru vers moi de sa chambre, je lui ai crié de s’allonger immédiatement par terre et un deuxième coup a retenti.
Après un certain temps, nous nous sommes levées et nous avons regardé par la fenêtre pour voir si quelque chose avait été endommagé, ou si de la fumée montait quelque part. Ensuite, la défense anti-aérienne a riposté. Je n’avais pas peur de mourir, mais j’avais peur pour d’autres vies, pour ma mère, pour mes chiens.
À ce moment-là, la ligne de front commençait à se rapprocher des frontières de notre région. Il y avait une peur terrible de l’occupation. Boutcha et d’autres villages alentours n’avaient pas encore été libérés, et le monde n’avait pas encore vu les horreurs de l’occupation russe. Moi, j’avais bien su et vu tout cela de mes propres yeux en 2014, alors que je conduisais l’aide volontaire dans l’est de notre pays.
La peur était plus forte que moi. J’ai décidé que je devais quitter la ville. Ma mère ne voulait partir sous aucun prétexte, j’ai dû la presser en lui montrant des photos et des vidéos des villages et villes occupés. Ça a été une décision très difficile à prendre. Je me suis dit que ce n’était qu’un voyage, comme si on avait décidé d’aller passer le printemps et l’été dans les Balkans.
Mais en réalité, ma vie s’est mise en pause. Je suis comme morte depuis le 24 février. Je mange, je respire, je fais des choses, j’emmène même mon chien à des expositions en Serbie. Mais tout ça ne rime à rien. Je ne fais pas ces choses parce que je le veux, mais parce qu’il faut le faire. J’ai arrêté ma vie. Et je ne suis pas sûre de la retrouver un jour.
Cet article est publié avec le soutien de l’ambassade de Suisse à Belgrade et de la Fondation Heinrich Böll en Serbie.