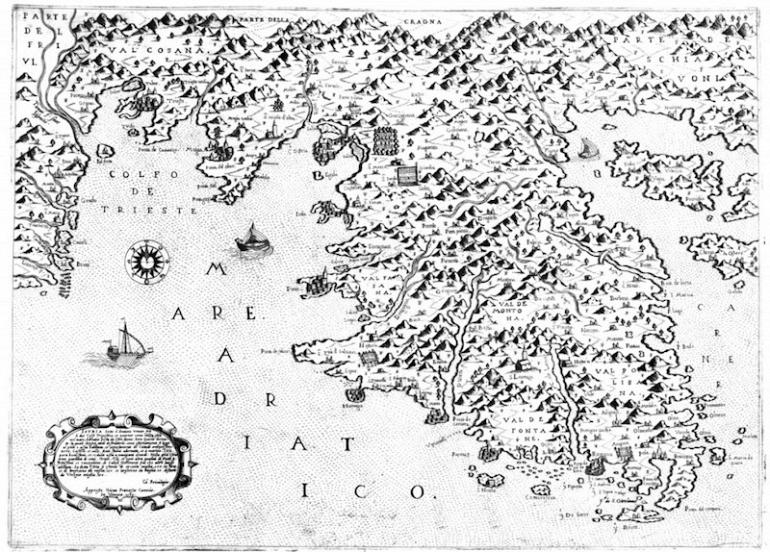La nouvelle mode en Istrie est au tourisme rural, hors du chaos des villes touristiques de la côte, prises d’assaut pendant les mois estivaux. Le touriste avisé se réfugie dans des petits bleds éperdus au fin fond de l’Istrie, où il peut jouir de la paix et du calme de lieux presque abandonnés, d’un climat plus agréable, surtout la nuit et, grâce aux fonds européens, de maisons confortables, les vieilles demeures en pierre délabrées ayant été transformées en gîtes ruraux agrémentés de piscines privées pour favoriser le tourisme.
Certes le paysage du Kars est bouleversé par ces bassins d’eau imprévus, parfois très visible le long de routes discrètes, quand même fréquentées pendant la période estivales. Dans les villages, normalement peu habités pendant l’année, et repeuplés lors de la période estivale, à côté de la famille rentrée de l’étranger, parlant exclusivement le patois local, on entend parler d’autre langues étrangères, surtout le français, comme j’ai pu le remarquer cette année.
Pour les touristes italiens, il y a encore la chance de rencontrer quelques opérateurs touristiques qui prétendent parler indifféremment le croate ou l’italien et qui, lorsqu’ils virent à l’italien, s’expriment en istro-vénète, au point d’être difficilement compréhensibles par des touristes venus de Rome, dont l’oreille n’est guère habituée aux dialectes du nord de l’Italie.
Une chose est certaine, ceux qui parlent encore l’istro-vénète, l’ont appris en famille, parce que, comme le souligne une étude réalisée il y a cinq années sur les structures communicatives de la langue italienne en Italie, l’istro-vénète était parlé par les italophones autochtones de l’Istrie, dont le nombre s’est énormément réduit depuis l’exode consécutif à la Seconde Guerre mondiale, et qui continue à diminuer depuis 70 ans.
L’istro-vénète pouvait être uniquement appris en famille en tant que dialecte utilisé exclusivement pour la conversation orale, voire intime de la famille, d’autant plus intime qu’après l’exode, les italophones autochtones restés en Yougoslavie ont préféré s’assimiler à la population locale.
Dans mon histoire personnelle, l’istro-vénète c’est la langue des l’affects, la langue avec laquelle je parlais enfant à ma grand-mère et à mes tantes et oncles qui, bien que n’étant pas italophones, puisaient dans leurs souvenirs pour récupérer quelques mots de cette langue qui était parlé autrefois en Istrie.
Pour cette raison, adulte et parlant croate, je suis devenue particulièrement sensible à ce dialecte, qui a poursuivi sa lente disparition ses 30 dernières années. Néanmoins, j’ai encore l’heureuse chance de pouvoir l’entendre dans l’aire d’origine de ma famille, près de la frontière avec la Slovénie, grâce à deux femmes extraordinaires qui ont survécu au XXème siècle et qui ont désormais plus de 90 ans.
Leurs vies pourraient être le sujet d’un roman, tant elles ont été denses d’événements, tant historiques que personnels, mais il suffit de rappeler qu’elles ont toutes deux reçu pour des raisons historiques une scolarité en langue italienne, l’une pour la durée de cinq ans, l’autre de sept. L’une des deux affirme de ne pas savoir parler correctement le croate, ne l’ayant pas étudié, et ayant utilisé dans sa vie plutôt le dialecte local de son village. Les deux ont pu conserver l’usage de l’istro-vénète grâce aux contacts, autrefois réguliers, avec leur famille vivant en Italie et revenant en visite de temps en temps. La première parce la famille de son mari était d’origine italienne et lui aussi était un italophone autochtone, la deuxième, la soeur de ma grand-mère, par la famille de sa soeur, qui avait fui en Italie à cause du mariage de ma grand-mère avec un Italien.
La chose la plus surprenante est la capacité presque immédiate de ces deux femmes âgées de virer à l’istro-vénète, alors qu’il leur arrive de ne l’utiliser plus guère qu’une fois par an. En vérité, les mécanismes du cerveau humain sont mystérieux et l’envie de communiquer et de partager de l’être humain dépasse toute barrière.