
Ce petit livre (119 p.) comporte en deuxième partie un corpus de 15 textes brefs bilingues allant du « peuples des Pélasges » cité par Eschyle à une supplique dans laquelle Georges Brassens qualifie les habitants de sa ville natale d’autochtones. A la fin du livre on trouve une impressionnante Bibliographie, classée par thèmes et commentée. A en juger par le nombre et la qualité des études et ouvrages parus en français ces derniers temps sur l’autochtonie et les thèmes connexes on réalise l’importance accordée en France au traitement critique de cette problématique.
Autochtone : du grec autochthôn, de autos « soi-même » et chthôn, « terre »
La démarche de l’auteur est annoncée par une série de mises au point d’ordre philologique. En effet, s’agissant des mots anciens tels que « autochtone » ou « autochtonie », mais aussi « démocratie » par exemple, la prise en considération de leur histoire et de leur sens étymologique, « celui auquel on ne cessera jamais de revenir au-delà des modes lexicales et des significations secondes » (p. 19), est indispensable. Le lecteur est ainsi invité à une promenade savante et tout en nuances dans le dédale des significations de l’autochtonie dans la Grèce ancienne et plus particulièrement à Athènes, la cité dont le mythe fondateur repose sur la naissance mouvementée du futur roi Erichthonios. Comme Héphaïstos, le dieu forgeron, tentait d’abuser Athéna, du sperme souilla le vêtement de laine de la déesse. De dégoût, celle-ci jeta l’étoffe au sol. Gaïa, la terre, reçut le linge en son sein et engendra Erichthonios - dont le nom vient du grec érion (la laine) et chthônios (sous la terre). Emue quand Gaïa le lui présenta, Athéna, la déesse vierge protectrice d’Athènes, finira par l’adopter, selon une des nombreuses versions de la légende.
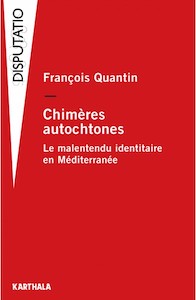
Le récit autochthonique, rappelle l’auteur, fait de la « polis (cité) un grand oikos (maisonnée), une phratrie ou un gènos. Platon le tient pour un « pieux mensonge », indispensable cependant pour assurer la cohésion sociale (p. 32). Les communautés qui se disent autochtones constituent plutôt une exception, la plupart des sociétés grecques ont « forgé des histoires singulières (…), fondées sur l’éparpillement, la dissémination », ce qu’on appelle aujourd’hui diaspora. Contrairement à elles, la cité athénienne semble avoir fait le choix de l’« ancrage territorial » (p. 35).
Mais, précise l’auteur, « les Athéniens établirent une autochtonie qui ne constituait pas une idéologie radicalement excluante, puisqu’ils savaient intégrer de nouveaux citoyens » alors que « L’usage actuel du mot autochtonie dans la rhétorique nationale renvoie à une présence ancienne, ancestrale, immémoriale qui exclut du groupe ainsi désigné les nouveaux arrivants même si leurs familles sont résidentes depuis des générations » (p. 74). Ainsi, « en promouvant un rapport génétique et matriciel au sol le discours moderne sur l’autochtonie relève d’un assemblage mythologique et idéologique à qui l’Antiquité (…) ne donne pas de légitimité », poursuit-il (p. 75). Puis il ajoute : « Si la leçon grecque doit être accueillie avec précaution en matière d’autochtonie, il est une autre notion hellène que nous aurions profit à travailler, celle de citoyenneté » (p. 76).
L’autochtonie « illyrienne donc albanaise » au temps d’Enver Hoxha
C’est ce raisonnement étayé par des arguments difficiles à réfuter qui conduit cet auteur à dénoncer dans des termes très forts les absurdités, les impasses et les affronts auxquels a pu conduire en Europe le discours politique au nom de l’autochtonie, discours qui se pare souvent de références à l’Antiquité. L’éventail des situations pointées est large : depuis la légitimité du territoire français fondée sur l’emprise géographique de « nos ancêtres les Gaulois » (p. 39) jusqu’au recours dans les « Post Colonial studies » au concept d’autochtonie pour s’opposer à l’universalisme jugé trop marqué par la pensée européenne (pp. 66-67) ou encore à certains courants écoreligieux de la culture New Age fondés sur le culte de la Terre Mère (pp. 60-61) en passant par les querelles opposant les ayants droit potentiels à l’appellation "Macédoine" (p. 39) ou encore par la thématique de l’autochtonie « illyrienne donc albanaise » relancée par le nationalisme archéologique promu sous Hoxha en Albanie ( p. 52). C’est d’ailleurs ce dernier point, évoqué par l’auteur dans une émission sur la Radio-télévision suisse, qui a attiré mon attention sur le livre de François Quantin, passionnant à tout point de vue et à mettre entre toutes les mains dans les Balkans.
L’identité collective, un abus de langage ?
Une question reste cependant par moi ouverte. « … Le véritable sens de l’origine étymologique du terme ‘’identité’’ - la latin idem, ‘’le même’’ ou identitas, ‘’qualité de ce qui est identique’’ - ne prête à aucune confusion car il n’est pas le produit d’une élaboration complexe ou d’une mythographie fantasque. Notre identité est ce qui constitue l’individu en tant que tel. L’extrapolation vers le collectif, la nation, le peuple est proprement un abus de langage. », lit-on à la page 54. Puis, plus loin, à la page 58, après avoir pris note de la vitalité actuelle du récit national, l’auteur écrit : « L’identité nationale’’ est une aliénation en ceci qu’elle dissocie le futur et l’avenir. Elle pourrait être avec profit remplacée par la recherche d’un idéal national, d’un projet. Une identité collective ne saurait être exclusivement fondée sur le passé, a fortiori sur un leurre comme l’autochtonie, mais doit aussi être instituée par un projet collectif… »
Autrement dit, une fois connectée à un projet, l’identité collective cesserait d’être un abus de langage. Un tel infléchissement, puisque l’identité collective en question continue d’être fondée sur le passé, suggère-t-il la possibilité d’une solution de compromis ? Si tel est le cas il faudrait peut-être le dire et être plus explicite.
PS : Mieux vaut parler, me semble-t-il, d’usage souvent discriminant du mot « autochtone » que d’usage discriminant tout court, comme je l’ai indiqué dans le chapeau de cette chronique. Dans maintes situations, le déni d’autochtonie de l’Autre peut se révéler encore plus blessant que la revendication de l’autochtonie. La querelle sur les premiers occupants de la Transylvanie avant et après le traité de Trianon de 1920 est un bon exemple dans ce sens. Traités d’« infiltrés » par les Hongrois, les Roumains traitent à leur tour les Hongrois d’« envahisseurs ». L’effet de telles accusations n’est évidemment pas le même selon qu’elles étaient proférées au temps de l’administration hongroise de la Transylvanie, jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, et roumaine, depuis cette date.








