Dido Sotiriou, Terres de sang, traduit du grec par Jeanne Roques-Tesson, ed. Cambourakis, 2018, 406 pages, 14 euros.
Qui connaît en France, mis à part quelques passionnés de l’histoire des Balkans et de l’empire ottoman, ce que les Grecs ont appelé la « Grande catastrophe » ? La fuite vers la Grèce, consécutive à la guerre gréco-turque (1919-1922), dans des conditions apocalyptiques, de plusieurs centaines de milliers de Grecs de Smyrne, d’Ephèse ou de simples villages anatoliens, leur terre natale et celle de leurs ancêtres depuis des générations et même depuis l’Antiquité. Les Turcs musulmans de Grèce devaient prendre quant à eux le chemin inverse. Les historiens estiment à 1,2 million le nombre des chrétiens orthodoxes qui ont fui la Turquie naissante de Mustafa Kemal et à 400.000 celui des musulmans de Grèce qui ont gagné la Turquie ; de gigantesques déplacements forcés de populations basés sur l’homogénéité nationale et religieuse, actés par le traité de Lausanne, en 1923.
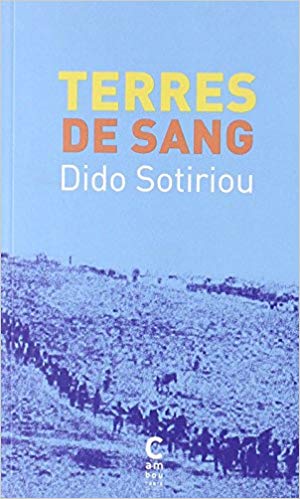
Cette tragédie quelque peu oubliée à l’ouest de l’Europe, Dido Sotiriou (1909-2004), elle-même originaire de la région de Smyrne, la raconte dans Terres de sang, magnifique roman qui connut un succès considérable en Grèce dès sa parution en 1962, avec près de 70 éditions, et que les éditions Cambourakis ont eu la bonne idée de rééditer en poche pour les lecteurs français, traduit par Jeanne Roques-Tesson. Pendant plus de trois cents pages, on suit les péripéties du narrateur, Manolis Axiotis, un jeune Grec quelque peu candide de la région de Smyrne balloté par l’Histoire et qui affrontera mille morts.
Tout commence par ce qui ressemble beaucoup aux souvenirs idylliques d’un passé où Turcs et Grecs vivaient en bonne entente et mieux que cela, s’appréciaient mutuellement. "Nous n’avions pas de Turcs dans notre village - même si c’était le turc que nous parlions (…) Les Turcs des villages environnants (…) nous respectaient et nous admiraient" , écrit Dido Sotiriou qui a mis, c’est évident, beaucoup de souvenirs personnels dans ce livre. L’amitié entre le narrateur de "Terres de sang", Manolis Axiotis, et Chefket, le copain d’enfance turc, a le parfum de l’autobiographie. Dido Sotiriou, communiste et militante féministe, plaidera d’ailleurs toute sa vie en faveur de la réconciliation entre les peuples grec et turc .
Cet Eden va sombrer rapidement dans une décennie de violences et d’horreurs croissantes entamée avec la guerre balkanique de 1912, puis le premier conflit mondial qui sera fatal à l’empire ottoman et enfin l’anarchie qui dévasta pendant plusieurs années durant l’Anatolie, livrée aux hordes diverses et aux appétits de la Grèce. Un général nommé Mustapha Kémal va présider au sursaut turc et mener une guerre impitoyable qui contraindra les Grecs au départ. Il y aura des atrocités de part et d’autre.
Mais Dido Sotiriou le répète à plusieurs reprises dans "Terres de sang", Turcs et Grecs pouvaient s’entendre sur une même terre et on ne retrouve pas chez elle le pessimisme foncier sur les relations entre communautés et même l’humanité que l’on retrouve par exemple dans l’œuvre du yougoslave Ivo Andric. Elle est persuadée que les peuples ont été avant tout les victimes de forces et d’intérêts étatiques qui les dépassaient, simples fétus de paille dans les convulsions de l’Histoire .
L’écrivain s’efface presque toujours derrière le récit du narrateur, nourri, c’est évident, de témoignages et de choses vues et entendues, donnant au livre une épaisseur vraie, culminant avec le départ désespéré de Smyrne pour les îles de la mer Egée, un départ que les Grecs dans cet enfer, ne peuvent imaginer définitif. Ils veulent le croire provisoire.
Dido Sotiriou glisse néanmoins de rares commentaires sur ces pages tragiques des histoires grecque et turque. "La guerrre ouvre des abîmes dans les âmes et chez les peuples. Vous les Grecs, fait-elle dire à un personnage, vous aviez jadis dans votre mythologie une Circé qui transformait les hommes en pourceaux, dès qu’elle les touchait. Aujourd’hui, Circé, c’est la guerre !"
On suit dans "Terres de sang" les tribulations de Manolis Axiotis, chassé du foyer familial par un père autoritaire et qui tente tout d’abord de trouver un emploi dans Smyrne, l’actuelle Izmir, dont la population est essentiellement grecque à l’époque. Mais la guerre le rattrape. "Quelque chose de terrible s’était mis en marche. Nous le devinions sans savoir à quoi ça pourrait ressembler". Il est enrôlé dans les redoutables "Bataillons du Travail" mis en place par les Ottomans, sorte de supplétifs où les conditions de vie sont inhumaines pour les Grecs. "Nous n’étions pourtant pas beaux à voir à l’époque : de vraies épaves, oui, des esclaves, des crève-la-faim qui vivaient dans le souvenir de la vie". Mais Manolis ne peut toujours pas concevoir que rien ne sera plus comme avant. "La Turquie n’était plus un Etat. Elle était gouvernée par des opportunistes, des magouilleurs, des filous et des spéculateurs", ne peut s’empêcher de souffler au passage Dido Sotiriou.
Car c’est bien une faune effroyable que croise le jeune homme pendant ses quatre années d’errances et d’évasions à travers l’Anatolie du début des années vingt, dans une atmosphère de fin du monde, avec les "tchétédjis", des irréguliers de l’armée turque connus pour leur férocité, et des déserteurs turcs prêts à tout pour sauver leur peau. Il y a quelques rares pages où l’humanité reprend ses droits brièvement. "On croise parfois de ces gens sur sa route ! Ils vous réconcilient avec la vie, même aux heures où elle vous paraît insupportable", assure Dido Sotiriou à son lecteur.
Manolis a même une brève idylle avec une paysanne turque qu’il ne reverra jamais. Il regagne son village mais très vite, il doit s’enrôler dans les troupes grecques cette fois-ci débarquées en Anatolie. Nouvelles épreuves, nouvelles atrocités entre les deux peuples et enfin le repli, la débâcle vers la côte, sous les coups de boutoir des troupes de Mustafa Kemal, l’adieu à Smyrne enfin, livrée aux flammes et à la vengeance. "Seule la peur rôdait dans les venelles sombres, tel un veilleur qui annonçait l’aube la plus cruelle qu’ait jamais connue le peuple grec".
On éprouve presque le besoin de souffler à la fin de ce roman puissant et à l’intensité croissante, reconnaissant d’avoir découvert ces pages méconnues de l’Histoire. "A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923", une exposition au Musée des Armées, aux Invalides, permet jusqu’en janvier de mieux nous éclairer sur les convulsions qui ont accompagné, il y a un siècle maintenant, l’effondrement de l’empire ottoman et des autres empires du centre de l’Europe.









