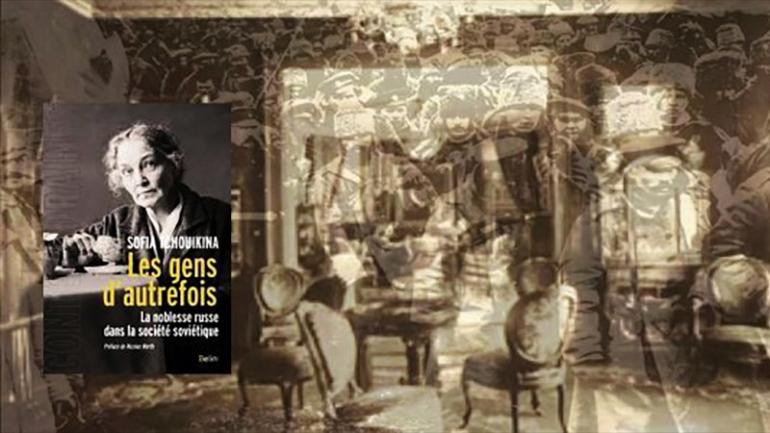« Les gens d’autrefois ». Que cache ce beau titre ? On désignait de la sorte en Union Soviétique les représentants de l’ancienne noblesse. Car tous n’ont pas émigré après 1917 ou ont été exterminés pendant la guerre civile, comme on aurait tendance à le penser. Beaucoup ont choisi de rester en Russie pour des raisons diverses, attachement au pays, attentisme ou encore par simple apathie. C’est l’objet précisément du travail de l’historienne russe Sofia Tchouikina qui s’est intéressée à ce sujet tabou jusqu’aux dernières années de l’URSS. Elle a recueilli dans les années 90 les témoignages des derniers survivants de l’aristocratie nés avant la Révolution, dans les années 1910. Mais elle a également puisé dans les archives, la presse, les chroniques familiales, les souvenirs, autant de documents qui donnent à son livre une grande densité humaine sur les parcours, les épreuves, l’esprit d’adaptation et la résilience d’hommes et de femmes confrontés en raison de leurs origines sociales à des difficultés immenses. « Les conditions qui présidèrent à la reconversion des nobles russes dans la nouvelle société soviétique, écrit l’auteure, sont sans équivalent en Europe au XX-ème siècle, au vu de l’ampleur et de la durée de la répression et de la discrimination exercées à leur encontre ».
Combien sont restés dans la jeune Russie soviétique ? Sofia Tchouikina, qui est maître de conférences à l’université Paris-VIII Vincennes-Saint Denis et chercheuse à l’Institut des Sciences sociales du Politique, préfère ne pas avancer de chiffres mais l’historien Nicolas Woerth évoque « plusieurs millions » de personnes dans la préface de l’ouvrage. Si les représentants des familles les plus prestigieuses subirent des répressions féroces dès le lendemain de la Révolution, d’autres pouvaient davantage passer inaperçus dans un premier temps et se fondre dans la population, car leurs origines nobles ne transparaissaient pas obligatoirement dans leurs noms, comme cela est le cas pour les aristocrates français par exemple. Et l’un des mérites de Sofia Tchouikina, dont l’enquête porte essentiellement jusqu’à la seconde guerre mondiale, est de montrer la diversité des réactions de l’ancienne noblesse à l’égard du régime soviétique. Beaucoup pensèrent, comme l’ensemble des citoyens soviétiques, que le régime allait s’assouplir au lendemain de la guerre civile et qu’ils pourraient s’adapter à leur nouvel environnement. Dans les années vingt, le régime avait cruellement besoin de spécialistes et de techniciens. Les nobles purent trouver un emploi, en dépit des stigmatisations dont ils faisaient l’objet.
Certains, qui étaient de grands propriétaires terriens avant la Révolution, mirent leurs compétences agricoles au service de la communauté, tandis que d’autres mettaient à profit leurs connaissances des langues étrangères, et notamment du français, pour dispenser des cours et s’assurer ainsi des moyens de subsistance. Certains enfin s’imposèrent dans différentes disciplines culturelles, danse, théâtre, qu’ils pratiquaient à titre privé avant la Révolution.
« Vu la précarité de leur statut, les nobles durent effectuer des changements fréquents au cours de leur vie professionnelle », écrit Sofia Tchouikina. L’historienne évoque par exemple l’itinéraire étonnant d’un certain Boris Liouba qui fut tour à tour comptable, professeur de tactique militaire, musicien et chef d’orchestre !
Le "Grand Tournant" imposé par Staline à la fin des années 20, avec le début de la collectivisation, entraîne un immense bouleversement de l’ensemble de la société, aggravé encore par les répressions et les purges. Les représentants de l’ancienne noblesse, dont Staline se méfiait particulièrement, n’y échappent pas. Ils font tout pour se faire oublier. Ils préfèrent s’exprimer entre eux en français pour tromper les services d’écoute, ou ont recours à un langage codé, « les trois lettres » désignant le GPU, la police politique stalinienne.
Les témoignages cités dans le livre, issus des entretiens de l’auteure, donnent une saveur et une puissance d’évocation sans pareille : « pour une assiette de soupe, on pouvait obtenir un cours de français. Pour une assiette de soupe, on avait un cours de musique », se souvient une certaine Tamara V. La proximité inhérente aux appartements communautaires, où plusieurs familles étaient contraintes de coexister, favorisait des échanges de services inattendus, comme ce matelot qu’une aristocrate aida dans ses études. « En contrepartie, chaque fois qu’il retournait dans son village, il rapportait une grosse oie, qu’il coupait en deux : une moitié pour lui, l’autre pour nous ».
Et ceux qui espéraient faire des études en dépit de leur origine sociale, qui leur fermait toutes les portes, se décidaient à travailler à l’usine pour pouvoir être considéré comme ouvrier, facilitant de la sorte leur entrée à l’université.
Sofia Tchouikina aborde enfin ce qui est peut-être le plus difficile à évoquer, l’impondérable, à savoir comment ces anciens représentants de l’aristocratie cherchaient à préserver leur identité. « La noblesse, qui servait encore d’identité à certains, était vécue comme un sentiment intime qu’on gardait au fond de soi ». Une femme née en 1930 confie à l’auteure : « nous ne parlions pas du passé à nos amis, même aux plus proches (…) Mais ceux qui nous étaient vraiment proches devinaient tout sans qu’un seul mot soit prononcé ». Les nobles cherchent également à parfaire l’éducation de leurs enfants, en leur apprenant quelques mondanités ou en organisant des spectacles familiaux, très fréquents dans les familles aristocratiques d’avant la Révolution.
Dans les années soixante, après l’étau stalinien, certains furent tentés de revoir leur « petite patrie », où leurs ancêtres avaient leur propriété. Mais il s’agissait d’une visite furtive et discrète, sans contact avec les habitants du lieu. Une telle visite était souvent source de frustrations car tout avait changé, y compris les anciennes demeures familiales, en bois, qui avaient disparu. Ce n’est que plus tard, après la chute de l’URSS, que les liens se sont rétablis, des centres culturels ou musées locaux se montrant très demandeurs de témoignages ou d’archives familiales de la noblesse locale
Beaucoup d’anciens aristocrates avaient été cependant élevés dans l’ignorance du passé familial, "moins tu en sauras, mieux ça vaudra", souffle un parent à une enfant à la fin des années trente. Ils vont dès la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev, dans des associations des descendants de la noblesse, partir « à la recherche de leurs racines » et « écumer les bibliothèques et les archives publiques publiques pour s’informer sur le passé prérévolutionnaire de leur propre famille ».
Sofia Tchouikina, Les gens d’autrefois. La noblesse russe dans la société soviétique, Belin, 326 pages, traduit du russe par Karine Guerre et et Ekaterina Pichugina.