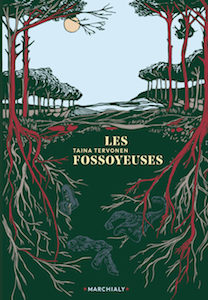
Une anthropologue, une enquêtrice, une journaliste : trois femmes font parler les morts et les vivants, en quête de vérité dans un pays marqué par la guerre. Senem est anthropologue judiciaire, et Darija enquêtrice. L’une travaille avec les morts, l’autre avec les vivants, dans un pays traumatisé par les guerres des Balkans : la Bosnie-Herzégovine.
Ces deux femmes d’une trentaine d’années n’ont pas choisi leurs métiers très particuliers, liés à l’histoire de leur pays. Senem est chargée d’identifier les ossements humains retrouvés dans des charniers vieux de dizaines d’années, quand Darija se rend dans les familles comptant des disparus pour écouter leur parole et prélever leur ADN.
Lorsque Taina rencontre Senem et Darija, la journaliste n’a aucune idée de l’ampleur de leur travail sur les disparus. Elle va suivre pendant plusieurs mois leur quête de vérité, essentielle pour l’histoire de leur pays et pour les familles qui n’ont jamais pu faire le deuil des êtres perdus.
Taina Tervonen est documentariste et journaliste indépendante pour la presse finlandaise et française depuis plus de vingt ans. Elle écrit depuis toujours sur la famille, les migrations, les récits de vie. Son travail a été récompensé par le prix Louise-Weiss du journalisme européen et le prix international True Story Award.
Le mot de l’autrice
« Pourquoi on te parlerait ? »
La voix est dure. Mirela lance sa question comme ça, comme on sortirait une épée de son fourreau, comme on claque une porte, comme on plante un piquet dans le sol pour marquer une limite, propriété privée, ne pas entrer. C’est un mercredi soir à Sarajevo, le premier soir de mon tout premier voyage en Bosnie, où je suis venue par curiosité et avec une question en tête : comment on fait pour vivre avec la mémoire de la guerre, vingt ans après les faits ?
« Il n’y a que deux raisons de parler, c’est l’envie ou le besoin », je réponds, parce que c’est la seule réponse qui me paraisse honnête à ce moment-là.
Elle me fixe un court instant et commence à raconter. La nuit est tombée depuis longtemps quand elle s’arrête, des cernes se sont creusés sous ses yeux, et les miens picotent de fatigue et d’émotion contenue tant bien que mal.
Dix ans plus tard, quand je commence à écrire Les Fossoyeuses, ma curiosité du début me paraît bien naïve, presque gênante. Pourtant, c’est ainsi que les histoires commencent, souvent : par une question obsédante qui nous conduit ici et là, d’une maison à une autre, d’une rencontre à une autre ou, dans cette histoire précise, d’un charnier à une morgue, d’une morgue à un cimetière, d’un cimetière à un café ombragé puis à une petite Ford Fiesta bleue, et des années plus tard, à défaut d’avoir trouvé une réponse, j’observe le récit qui s’est tissé, cercle après cercle, autour de cette matière dont j’ignorais totalement la complexité et la délicatesse, face à la question-épée de Mirela. Le récit s’est tissé, et je suis dedans.








