
« Ma liaison avec Paris serait longue : quatre décennies. En réalité, il y eut deux Paris, celui du temps du communisme et l’autre, intemporel, chacun occupant une tranche d’une vingtaine d’années ».
Le ton est donné dès les premières pages par le grand écrivain albanais qui partage toujours son temps entre Paris et Tirana. Et c’est au café Rostand, face au jardin du Luxembourg, qu’Ismaïl Kadaré a pris ses habitudes au fil des années pour y lire, écrire ou prendre des notes. Dans cette série de textes inédits souvent teintés d’une ironie légère et parfois de nostalgie, Ismaïl Kadaré partage ses souvenirs et réflexions sur son parcours, lui qui eut la possibilité inouie au début des années soixante-dix de partir quelques jours pour la capitale française alors que son pays « vivait sous la coupe d’une dictature qui, en plus d’être la plus cruelle de toutes, était également la plus mesquine ».
Le premier contact de l’auteur avec Paris, suite à une invitation mystérieuse dont il ne parviendra pas à percer l’origine, finissant même par douter de son existence, nous valent quelques pages saisissantes sur l’impression de songe, comme hallucinée, qu’il a de la ville. On imagine sans peine l’effarement de l’écrivain, lui qui venait de l’un des pays les plus fermés du monde. « Plus que d’un voyage à Paris, il s’agissait d’une ouverture du monde souterrain, pour une durée limitée, inscrite sur le passeport, avant de regagner, une fois ce délai écoulé, le cul-de-basse-fosse albanais. L’arrivée, quelque forme qu’elle revêtit, était déboussolante. Une bête sauvage en cage, un fou, un revenant n’aurait pas pu être plus effrayé par les lumières de l’aéroport d’Orly que l’écrivain du réalisme socialiste foulant pour la première fois ce monde, ignorant si c’était encore le sien ».
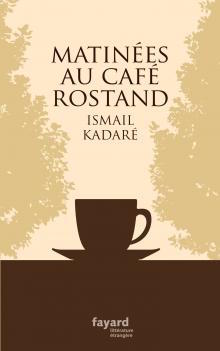
Ismaïl Kadaré, régulièrement pressenti pour le prix Nobel et qui est âgé aujourd’hui de 81 ans, évoque aussi ses séjours ultérieurs dans la capitale française. Il raconte par exemple, amusé, comment Patrick Modiano et lui-même, tous les deux habitants du quartier et pleins de réserve naturelle, s’observaient du coin de l’œil au détour des allées du jardin du Luxembourg, hésitant à s’aborder, alors que l’un et l’autre savaient parfaitement qui était ce promeneur timide. Un passage savoureux est consacré aux difficultés qu’il eut une fois à obtenir une permission de sortie du territoire albanais, devant convaincre un fonctionnaire suspicieux qu’il partait pour se voir attribuer le titre d’officier de la Légion d’honneur et non pas de la Légion étrangère, comme le pensait le bureaucrate…
Il s’installera de façon plus prolongée à Paris au lendemain de la chute du communisme, au tout début des années 1990.
L’écrivain revient également sur son séjour à Moscou, sous Nikita Khrouchtchev, à la fin des années 50, un séjour qu’il évoque avec une nostalgie manifeste, lui qui n’était alors qu’un tout jeune apprenti écrivain. C’est l’époque du dégel où les esprits s’enhardissaient, la dissidence prenait son essor. Boris Pasternak se voit attribuer le prix Nobel. On devine toute la saveur de l’interdit que devait représenter pour ces jeunes intellectuels les cours de l’institut Gorki sur le « décadentisme mondial » qu’on leur promettait pour, disait-on, mieux savoir utiliser l’« antidote socialiste ». Car ces cours permettraient aussi à ces jeunes gens d’avoir un aperçu sur des littératures interdites et taboues. « À cause de Pasternak, nous avions cru que le cycle de leçons contre le décadentisme serait avancé. Tout au contraire, on l’avança. Pendant un bon moment, nous ne songeâmes plus qu’au trio maléfique : Kafka, Joyce, Proust ». Ismaïl Kadaré décrit très bien l’atmosphère qui règnait alors à Moscou, faites à la fois d’audaces et de crispations idéologiques.
Dans ce livre composé d’une vingtaine de textes, Ismaïl Kadaré passe en revue les thèmes les plus divers, au gré de son bon plaisir et de sa grande culture. L’écrivain revient souvent néanmoins aux cafés, convaincu que ces endroits et l’utilisation que l’on en fait sont le reflet d’évolutions profondes de la société. « Après la chute du communisme, le rapport des habitants de la capitale avec les cafés avait profondément changé. Non seulement leur nombre avait explosé, mais c’était là désormais qu’on règlait des affaires, se toisait, se disputait, et, à en croire la presse de l’époque, que les tueries les plus spectaculaires avaient lieu. Dans ce contexte, écrire au café, avant même de paraître incongru, était surtout devenu banal ».
« Matinées au café Rostand », c’est enfin un hommage à ces écrivains ou poètes albanais disparus dans la tourmente de la dictature. C’est là que l’émotion est sans doute la plus présente. Ismaïl Kadar les a tous connus. La trentaine de pages du chapitre intitulé « Un avril pour Fred » retracent ainsi le destin tragique du poète albanais Frederik Rreshpja (1940-2006) qu’Ismaïl Kadaré rencontrait au début des années soixante-dix au café Tirana, « lieu fréquenté alors par les intellectuels de la capitale » albanaise, appelé aussi de façon absurde le café des « trois moitiés ». « La moitié de ses clients (selon le « fou » à l’origine de cette appellation) était composée d’aliénés, l’autre moitié d’anciens détenus et la troisième de ceux qui le deviendraient ». Ismaïl Kadaré salue aussi la mémoire d’Engjëll Gjeci, « doux poète et homme de rare distinction que l’Albanie terrifiait par-dessus tout » et qui disparut un jour sans laisser de trace. Qui se souvient de ces écrivains emportés par la tourmente du XXe siècle ?
Ce n’est pas le moindre des mérites des « Matinées au café Rostand » de montrer qu’en dépit de cette dictature féroce que fut celle d’Enver Hodja, il y avait en Albanie des hommes et des femmes qui résistaient désespérément au formatage et à l’anéantissement des esprits, aspirant coûte que coûte à préserver un semblant de vie intellectuelle. Et Ismaïl Kadaré rend hommage au courage de tous ces artistes pour beaucoup oubiés.








