Fils d’une famille de mineurs de la région de Tuzla (nord-est de la Bosnie), Semezdin Mehmedinović étudie la littérature comparée à Sarajevo où il publie ses premiers poèmes en 1984. D’autres suivront, accompagnés de fragments et essais, rassemblés dans un recueil qui fera date : Sarajevo Blues (Ljubljana, Biblioteka egzil-abc, 1992). Journaliste engagé, cheville ouvrière de plusieurs revues durant le siège (1992-1996), Mehmedinović pratique alors la littérature en contrebande – essais et poésies sont les passagers clandestins de ses articles de presse. La fin du siège marque le début de l’exil aux États-Unis d’où il publie poèmes, échanges épistolaires et textes à caractère autobiographique – autant de réflexions sur la « vie mutilée » proposant une phénoménologie de la vie quotidienne dans la veine des Minima Moralia d’Adorno (1951).

D’un livre l’autre, toujours sur le seuil du présent, Mehmedinović poursuit le même objectif : rembobiner le film, sans cesse remettre en jeu le passé afin de le mettre à jour dans le présent, accéder ainsi pleinement à l’instant présent, un « présent infini » : « En cet instant, tous les événements de ma vie se déroulent à l’unisson dans l’espace. Ainsi, tous mes présents durent indéfiniment » (Le matin où j’aurais dû mourir, p. 160). Présent forcément inachevé à l’image des livres à fin ouverte ou d’une esquisse juste ébauchée au moment de conclure l’Autoportrait au sac (Autoportret s torbom, Zagreb, Fraktura, 2012). Dans le sillage de Schlegel, l’auteur tutoie le genre poétique dont « l’essence propre [est] de ne pouvoir qu’éternellement devenir, et jamais s’accomplir » (Fragment 116). L’œuvre à l’œuvre se révèle comme ouverture d’un infini saisi dans l’instant.
Cet « présent infini », le mot est de l’auteur, procède de la puissance de répétition, de l’« éternel retour » de Nietzsche dont Gilles Deleuze a saisi le tranchant : « Jamais l’instant qui passe ne pourrait pas¬ser, s’il n’était déjà passé en même temps que présent, encore à venir en même temps que présent. […] II faut que le présent coexiste avec soi comme passé et comme à venir » (Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962 (2014), p. 74). Mehmedinović piste une temporalité psychique polychronique qui travaille le temps suivant la voie du symptôme dont Freud avait saisi la magie : « Passé, présent, avenir donc, comme enfilés sur le cordeau du désir qui les traverse ».
Pour l’écrivain, la littérature procède de la forme, et celle-ci précède le contenu. D’où la similitude de structure des procédés esquissée dans Sarajevo Blues et mis en œuvre avec consistance aussi bien dans l’Autoportrait au sac que dans Le livre des fenêtres (Kniga prozora, Zagreb, Fraktura, 2014 ) et Cette fois maintenant (Ovo vrijeme sada, Zagreb, Fraktura, 2020) : la technique du montage de fragments, instantanés et miniatures urbaines – comme autant d’éclats du quotidien ; l’enchevêtrement des temps, le jeu de temporalités hétérogènes – comme nœuds d’anachronismes combinant passé et présent ; et l’assemblage de textes et croquis – comme espace intermédiaire à la fois verbal et pictural. Avec Le livre des fenêtres, l’écriture, forcément hybride, toujours poétique, éminemment libre, prend le large : fragments sans point final et recours au blanc offrent un texte tissé d’interstices à remplir par le lecteur.

Autant de livres d’un survivant – au siège de Sarajevo, à une crise cardiaque un deux novembre 2010, ainsi qu’à l’exil qui prend fin en 2019. Chaque fois le corps s’impose comme pivot autour duquel s’organise la vie de l’auteur, point capiton d’une écriture engagée simultanément dans le jeu vertigineux du temps, dans le labyrinthe de la multiplicité de niveaux mémoriels, et dans la folle course poursuite d’Éros et Thanatos. De cette expérience radicale surgit un souffle nouveau, un autre rapport au monde, la découverte du temps de l’enfance de l’homme, l’émergence du langage (l’écriture) et de l’image (le dessin).
On retrouve ces éléments dans Le matin où j’aurais dû mourir (Le Bruit du Monde, 2022) publié initialement en 2017 sous le titre « Me’med, Bandana rouge et flocon de neige » (Me’med, crvena bandana i pahuljica, Zagreb, Fraktura, 2017). Livre d’exil, récit d’une lutte à la fois pour l’identité, la mémoire et l’amour. Album de famille en forme de triptyque : « Me’med », le récit de la crise cardiaque et de l’hospitalisation du narrateur (2010) ; « Bandana rouge », à la fois lettre à son fils et carnet de voyage dans des déserts américains façon road-movie (2015) ; et « flocon de neige », le journal de bord d’un couple après l’accident vasculaire cérébral de sa femme (2016). Ces trois parties – à la fois indépendantes et imbriquées – se succèdent chronologiquement : chacune est composée de fragments anachroniques, scandés de contretemps et répétitions, donnant au récit un rythme soutenu, une énergie féérique, et toutes illustrent le temps comme jeu de forces et onde de choc dont l’écriture est le sismographe.
Le médicament que prend le narrateur depuis son accident a pour effet secondaire des pertes de mémoire. Aussi le voyage en Arizona avec son fils Harun a pour objectif d’en prendre la mesure. L’enjeu est de retrouver les souvenirs du siège et de l’exil en rattrapant les images des souvenirs communs : « Je suis venu ici dans l’intention de comparer ces souvenirs, afin d’en apprendre un peu plus sur mon oubli. Ai-je appris quoi que ce soit ? Non. En réalité, j’ai découvert que tu refoules certains souvenirs (principalement ceux de la guerre) dans l’oubli. Tes raisons sont compréhensibles. Je t’envie, car ce dont je me souviens avec le plus d’intensité, ce sont les événements que je préférerais oublier. La mémoire et l’oubli se tiennent l’un à côté de l’autre, ils sont faits de la même substance » (p. 112).
Pour Mehmedinović, l’artiste est un œil. Renouant avec son rêve d’enfant d’être peintre, l’écrivain trempe sa plume dans l’encre de ses images. Dans le carnet de voyage, le dessin accompagne l’écriture : « Il n’a pas la force du document, le dessin est peu fiable comparé à la réalité que l’on voit à l’œil nu, c’est pourquoi il vient fictionnaliser mon carnet de voyage. Et ce manque de fiabilité est une bonne illustration de mon voyage avec Harun, parce que ces jours-ci, mon passé s’est dangereusement confondu avec le présent » (p. 108).
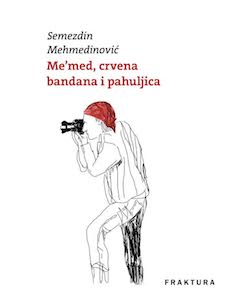
Les croquis désignent l’« instant infini » et scandent les « survivances », les répétitions loin de tout retour à l’identique : ce qui revient, ce sont des images, des ressemblances. De plus, ils restituent les émotions et poussent l’écriture à se déprendre du silence du désert traversé avec son fils pour énoncer le non-dit : le remord d’un père ayant contraint son fils à endurer le siège de Sarajevo (cf. pages 96 et 118) et l’invite à l’indépendance : « mon fils, je suis venu pour te débarrasser enfin de moi ! Voilà, tu es libre, pars dans ton désert » (p.121). Ce non-dit confronte le narrateur à sa nostalgie, celle d’un âge où tous les choix sont encore possibles : « à la fin de l’enfance, à cet âge délicat de l’adolescence, une infinité de voies s’ouvrent devant nous, et quelques années plus tard, quand nous nous limitons par notre choix à une seule, nous nous mettons à regretter le temps où nous pouvions choisir entre un grand nombre de possibilités. C’est cela, pour moi, la nostalgie » (p. 49).
Les motifs abordés dans les deux premières parties du recueil sont repris et développés dans la dernière. L’accident vasculaire cérébral un deux avril 2016 de Sanja, femme du narrateur, s’ajoute aux épreuves passées et ouvre de nouveaux horizons : « Les événements tragiques renforcent notre pulsion de vie et notre capacité à aimer » (p. 145). Et donc de reprendre ensemble la lutte : à nouveau convoquer les souvenirs communs ; arracher à l’oubli un événement, une image-souvenir « porte-mémoire » ; découvrir un présent tissé de passés multiples. Étant donné le régime discontinu de la temporalité avec ses remous, contretemps et hybridations, les fragments anachroniques participent au travail de mémoration et reconstruction.
C’est un combat pour la mémoire perdue des quelque quatre années effacées par l’accident dont l’effet paradoxal est de rapprocher les moments lointains, notamment lorsque l’on côtoyait des gouffres : « L’atlas de son monde est perturbé. Parfois elle se réveille convaincue d’être à Sarajevo » (p. 218). D’où cette inéluctable confrontation avec ce dont « nous ne voulons pas nous souvenir / la guerre est une terreur qui ne peut pas cesser / dans l’âme, dans le monde » (La rabbia, Film 35 mm noir et blanc et couleur, 59 mn, 1962-1963). Pasolini voit juste : la tragédie, c’est la tragédie de la mémoire, soit « la tragédie de notre mémoire défaillante du tragique » (Didi-Huberman, L’image survivante, 2002, p. 152) . De cette tragédie-là, l’écriture de Mehmedinović prend la mesure.
Quelle année, quel mois, quel jour ? « Quand je dis ‘c’est ma femme’, c’est un euphémisme, elle est bien plus que ça. En 1993, disons, pendant le siège de Sarajevo, un tueur a pointé le canon d’une kalachnikov sur ma poitrine. Elle s’est interposée entre la kalachnikov et moi » (p. 141). Au jeu de l’oubli et de la mémoire, celle-ci se révèle être une instance qui perd plus qu’elle ne retient. C’est cependant aussi une remise en jeu perpétuelle. Alternance du « c’est là » et du « c’est perdu » avec pour seule règle le Fort-Da. – la maladie ne faisant qu’intensifier le processus. Lien d’abandon et temps vertigineux des « survivances » devenant jeu, scène intime du couple, et œuvre du poète.
Alors, reste le corps, le sien et aussi celui de sa femme dont il prend soin à l’hôpital : « Son corps est pour moi un terrain connu, il a changé avec le temps, et je me souviens de lui dans ses différentes phases. Je me souviens de tous ses corps » (p. 153-154). Reste la langue : « Son parler est inchangé, le fonds de mots est resté le même. Si la langue est un miroir du monde, alors, rien de ce dont elle se souvenait (et qu’elle a à présent oublié) n’est perdu. Si la langue est conservée dans son intégralité, alors, tout son monde, qui réside dans la langue, est resté intact. Ce qui signifie que rien n’est oublié, et que maintenant, nous devons tout arracher à l’oubli » (p. 158).
Témoignages d’une « mémoire » coïncidant avec « le matériau des choses » (Friedrich Nietzsche). Les fragments sont autant d’opérateurs temporels de « survivances » au plan du temps et de la langue (ci-dessus) ou encore des lieux : « En entrant dans notre appartement, j’ai regardé les objets familiers autour de moi, et instantanément, je me suis dit que dans chacun de ces objets était inscrit un geste de Sanja. Elle a disposé chaque chose à sa place, les objets ont conservé l’éclat de son geste. Cette pensée était dangereuse, parce qu’inconsciemment, j’ai vu un monde où elle n’était plus là, juste le mouvement de sa main » (p. 139).
Ce carnet de route à la recherche du temps présent se termine par un bilan aussi lucide que beau : « Le malheur nous a réduits à notre essence. Il ne reste plus rien de nous, à part l’amour » (p 228).
Les constellations de fragments poétiques et d’images dialectiques de Semezdin Mehmedinović rejoignent la galaxie de Walter Benjamin : « Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi I’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation ».
Tel un sismographe, l’écriture enregistre l’onde de choc, l’onde de la mémoire de l’inouï du début du siège de Sarajevo. Ainsi, une nuit d’hôpital de novembre 2010 : « Moi aussi, dans mon passé, j’ai une année dont je ne suis jamais sorti. 1992. Parfois, je suis tiré du sommeil par les rafales de kalachnikovs au-dessus de Sarajevo. Je me lève, je me fais un café et je reste éveillé jusqu’à l’aube, je regarde par la fenêtre les lumières de Washington, ou la neige qui tombe sur le Pentagone » (p. 35). L’écrivain enregistre et transmet les mouvements invisibles qui attendaient le moment propice pour se manifester. Au lecteur d’en saisir la force, l’énergie et la portée.
On saisit là la marque de fabrique de l’auteur : l’enjeu, traquer dans les souvenirs et même dans les oublis ce qui en eux font trace et permet une mémoire, voire une renaissance ; et la méthode : un assemblage de fragments anachroniques esquissant un « présent réminiscent » (Pierre Fédida). Entre l’histoire qui « tue » le passé et celle où « (re)vit » le passé, soit une histoire « attisée par le souffle vivant du présent » (Friedrich Nietzsche, Considérations Inactuelles), l’auteur choisit la seconde. Celle précisément que Nietzsche qualifiait de « puissance artistique » : « la faculté d’entourer les choses d’une présence créatrice, de se plonger avec amour dans les données empiriques, de broder poétiquement sur des types de données ». Sur les pas de Nietzsche, Mehmedinović transforme l’histoire partagée avec son fils et sa femme en œuvre d’art.
À sa façon, installé sur le seuil de l’instant présent, Mehmedinović suit les pas de son père, mineur de profession. Comme lui, il détache du rocher des fragments pour remonter en surface le cristal, des « images fulgurantes » (Walter Benjamin). Plasticité du temps, jeu de l’oubli et de la mémoire, rapport de forces ; se souvenir certes, mais oublier parfois. En tous les cas ne pas rester prisonnier du passé, tendre à faire surgir un « éclair lumineux » car « c’est seulement quand il est assez fort pour utiliser le passé au bénéfice de la vie et pour refaire de l’histoire avec les événements anciens, que l’homme devient homme » (Friedrich Nietzsche).
Toujours aux prises avec la mémoire, mais cette fois maintenant de Sarajevo car de retour dans sa ville depuis juillet 2019, les temps de l’auteur se conjuguent désormais dans un seul espace. Mehmedinović avance vers l’avenir son regard fixé sur le présent poursuivant son œuvre mêlant subtilement littérature, essais et mémoires ; prose, poésie et croquis tout en restant fidèle au poète qu’il est. Comme Ulysse de retour à Ithaque, Sarajevo reconnaît les siens à leurs cicatrices.









